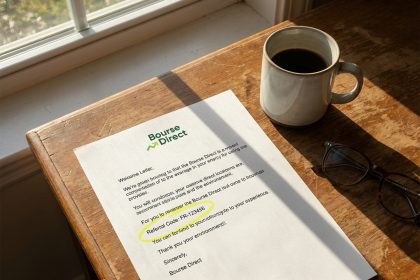Détenir du bitcoin en Égypte expose à des sanctions pénales, malgré l’absence de texte de loi explicitement dédié aux cryptomonnaies. La Banque centrale interdit toute émission, négociation ou promotion de monnaies virtuelles, tandis que les autorités religieuses assimilent ces pratiques à des actes illicites.
Les transactions réalisées sur des plateformes étrangères restent difficiles à tracer, mais la loi sur la lutte contre les crimes informatiques permet aux forces de l’ordre d’intervenir. Dans ce contexte, l’usage du bitcoin continue de se heurter à une réglementation stricte et à une hostilité institutionnelle persistante.
Le bitcoin face à la législation égyptienne : état des lieux
La réglementation égyptienne ne laisse aucune place à l’ambiguïté : la Banque centrale d’Égypte interdit fermement toute utilisation, émission ou échange de cryptomonnaies sur le sol national. Le code monétaire et financier classe ces actifs parmi les interdits, assimilant l’achat, la vente ou l’échange de monnaies virtuelles à des pratiques à bannir. À la source de cette posture : la crainte du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, dangers jugés trop présents.
Dans ce climat, les banques et institutions préfèrent s’en tenir à distance. Les mises en garde officielles se multiplient : les transactions en cryptomonnaies échappent à tout contrôle et à toute traçabilité. L’Égypte, contrairement à d’autres pays ayant instauré un encadrement légal spécifique, n’accorde aucun statut officiel au bitcoin. Ici, pas de place à une légalisation progressive.
Voici les grandes lignes à retenir sur la position égyptienne :
- Utiliser des cryptomonnaies lors d’échanges officiels demeure strictement prohibé.
- Le bitcoin n’a pas le moindre statut de monnaie légale.
- Toute transaction en cryptomonnaie expose son auteur à des poursuites pénales.
La dimension religieuse vient verrouiller un peu plus la situation. La finance islamique, guidée par les principes de la charia, pèse lourd dans la balance. Une fatwa officielle a tranché : le bitcoin et les cryptomonnaies sont jugés contraires à l’éthique islamique, accusés d’encourager la spéculation et l’incertitude. Résultat, la cryptomonnaie se retrouve doublement marginalisée, surveillée de près, et chaque tentative de régulation s’accompagne d’un contrôle renforcé sur les plateformes d’échange et les flux financiers.
Posséder du bitcoin en Égypte : quels risques juridiques et religieux ?
En Égypte, détenir du bitcoin revient à s’exposer à deux fronts : la justice et la morale religieuse. Aux yeux des autorités, acheter, conserver ou vendre des crypto-actifs est perçu comme une infraction directe à la législation monétaire. Aucune zone grise, aucune tolérance : le simple fait de posséder une cryptomonnaie, jugée illégale, peut mener devant les tribunaux, avec des accusations graves comme le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. Les peines varient, mais oscillent entre lourdes amendes et peines d’emprisonnement, selon la sévérité retenue par les juges.
Côté religieux, la sentence est tout aussi nette. Une fatwa interdit toute utilisation de cryptomonnaies, pointant les dangers de la spéculation, l’absence de garanties tangibles et la possibilité de faciliter des flux financiers illicites. Dans la logique de la finance islamique, ancrée dans la charia, la volatilité et l’opacité du bitcoin sont des défauts rédhibitoires. Posséder une cryptomonnaie, c’est donc prendre le risque d’être condamné moralement, en plus de s’exposer à la répression légale.
Les risques concrets auxquels s’expose un détenteur de bitcoin en Égypte sont multiples :
- Risque pénal : des poursuites judiciaires, la confiscation des avoirs, et parfois des peines de prison.
- Risque religieux : interdiction officielle, stigmatisation sociale et mise à l’écart de la communauté.
Le cadre réglementaire verrouille ainsi toute marge de manœuvre, réduisant à peau de chagrin l’espace pour l’innovation ou pour toute initiative privée autour des monnaies virtuelles. Quiconque s’aventure sur ce terrain s’expose à une double sanction, autant sur le plan juridique que sur le plan social.
Comparaison avec la régulation des cryptomonnaies dans d’autres pays africains
Le panorama africain offre des contrastes saisissants. Si l’Égypte campe sur une interdiction stricte du bitcoin et des cryptomonnaies, d’autres pays du continent tentent d’autres voies. En Afrique du Nord, Maroc, Algérie et Tunisie ont également opté pour la fermeture ou le contrôle serré. Mais plus au sud, les lignes bougent.
Au Nigeria, la première économie africaine en volume de transactions crypto, la jeunesse s’est saisie du bitcoin pour contourner un système bancaire peu accessible. Les autorités affichent des réserves, mais la répression demeure limitée et les échanges, principalement via des plateformes peer-to-peer, explosent. Ici, le bitcoin n’a pas de statut légal, mais l’usage s’impose par la pratique.
La République centrafricaine a tenté le grand saut : en 2022, le bitcoin y devient monnaie à cours légal. Un symbole fort, mais qui se heurte au quotidien à la réalité du terrain, entre manque d’infrastructure et faible adoption. L’Afrique du Sud, elle, préfère avancer pas à pas, encadrant les plateformes d’échange et imposant la déclaration des plus-values, sans pour autant couper court à l’innovation.
Quelques différences majeures illustrent cette diversité :
- L’Égypte maintient une interdiction totale, invoquant la défense de la stabilité monétaire.
- Le Nigeria et l’Afrique du Sud expérimentent, adaptent et encadrent progressivement les usages.
- La République centrafricaine a fait du bitcoin un symbole politique, sans transformation profonde du secteur.
Cette mosaïque de politiques témoigne d’une chose : l’Afrique cherche sa propre trajectoire, entre contrôle étatique, innovation financière et recherche d’inclusion, avec le bitcoin comme catalyseur de débats et de changements.
Défis et perspectives pour l’avenir des cryptomonnaies en Égypte
Impossible, pour l’instant, de contourner le verrou de la Banque centrale d’Égypte. Le bitcoin, comme tous les crypto-actifs, reste pris dans un carcan légal strict, où chaque transaction non autorisée peut coûter cher. Les sanctions visent la possession, l’usage et surtout l’échange sur des plateformes étrangères. Pourtant, la demande ne faiblit pas. De nombreux jeunes, confrontés à l’inflation galopante et à la fragilité de la livre égyptienne, cherchent des alternatives numériques pour protéger leur épargne.
La défiance officielle à l’égard des monnaies virtuelles s’explique par la volonté de prévenir le blanchiment d’argent et de garder la main sur la politique monétaire. Le secteur bancaire, encore très centralisé, observe d’un œil à la fois inquiet et intrigué l’essor de la blockchain et des actifs numériques. Menace ? Opportunité ? Le débat reste ouvert.
Une piste émerge toutefois : la Banque centrale étudie discrètement le lancement d’une monnaie numérique nationale. L’idée : moderniser les paiements et préserver la souveraineté monétaire, sans pour autant céder entièrement à la logique de la décentralisation.
Voici les tendances qui se dessinent pour la suite :
- La prudence et le contrôle restent les lignes directrices de la régulation égyptienne.
- Malgré les restrictions, l’accès aux plateformes d’échange étrangères n’est pas complètement bloqué, mais le risque juridique demeure réel.
- Un éventuel assouplissement dépendra des progrès réalisés en matière de conformité et de sécurité des transactions.
Pour l’instant, la scène du bitcoin en Égypte se joue à huis clos, entre interdits, espoirs de modernité et volonté de garder le contrôle. La question n’est plus de savoir si la cryptomonnaie s’imposera, mais quand et sous quelles conditions. Car les lignes, un jour, finiront par bouger.